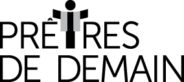Les défis missionnaires de l’Église
Le père Gilles Routhier doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval a aimablement accueilli la rédaction de la revue Univers entre deux rendez-vous pour parler notamment sur les défis missionnaires de l’Église et sur le Concile Vatican II, sujet de prédilection de l’illustre théologien québécois.

Il y a quelques temps, la rédaction de la revue Univers* a été à la ville de Québec. Plus précisément à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, où il a rencontré son doyen, l’abbé Gilles Routhier. Professeur et auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages, ce théologien de renommée internationale est souvent sollicité ici et ailleurs pour son expertise sur les domaines touchant l’Église catholique.
Homme très occupé – vous l’aurez deviné –, le père Routhier l’a aimablement accueilli entre deux rendez-vous pour parler notamment sur les défis missionnaires de l’Église et sur le Concile Vatican II, sujet de prédilection de l’illustre théologien québécois. Entrevue.
Racontez-nous un peu votre parcours :
J’ai été ordonné prêtre du diocèse de Québec en 1979. Les premières années j’ai travaillé en pastorale de la jeunesse qui était, en ce moment-là, un secteur à défraichir ou à ouvrir. J’ai travaillé également un peu plus que quatre ans au diocèse de Labrador-Schefferville – diocèse qui n’existe plus aujourd’hui –, là dans un contexte davantage missionnaire. Même si les gens ont été évangélisés, il s’agit d’une Église qui est encore missionnaire à bien des égards. Là-bas, j’ai passé quatorze mois à la Baie d’Hudson et à l’Ungava, et ensuite en basse Côte-Nord. Ensuite, j’ai retourné aux études pour quatre années à Paris. De retour au pays, j’ai commencé mon ministère paroissial à Québec. C’est alors qu’un poste s’est ouvert à la Faculté. Et comme elle était catholique, l’évêque de l’époque tenait à ce qu’il y ait une présence de prêtres. Donc, j’ai fait candidature et j’ai commencé à enseigner à titre de professeur adjoint en 1992.
Vous avez faite de nombreuses études, publié de nombreux livres : il y a-t-il un domaine en particulier dont vous teniez à explorer?
Mes intérêts sont assez liés aux domaines d’enseignement. Il y a l’ecclésiologie – aussi bien du point de vue théorique que des pratiques de gouvernement ecclésial comme paroissiales. Il y a aussi tout le domaine de la théologie pastorale – l’éducation de la foi, notamment. Enfin, il y a eu une recherche principalement sur le concile Vatican II.
Le concile Vatican II vous a-t-il marqué beaucoup?
Certainement. De toute manière, qu’on en soi conscient ou pas, on ne peut pas vivre dans l’Église catholique aujourd’hui, on ne peut pas comprendre son devenir, en dehors de cette référence. Mieux vaut en être conscient.
Il y a quasiment un avant et un après Vatican II, non?
Oui, d’un certain point de vue. Vatican II a ouvert une autre page dans la vie de l’Église catholique, mais cette autre page n’est pas détachée du livre. Si c’est une page nouvelle, ce n’est pas une page qui serait sans lien avec ce qui précède.
50 ans après cet évènement, quel en est votre regard?
On a beau être en 2014, mais nos questions d’aujourd’hui, pour la plupart, sont des questions qui ont été au moins abordées à Vatican II. Que l’on parle du rapport avec les autres religions – ce qui est important dans l’activité missionnaire –, Vatican II est le premier concile qui a abordé ex professo cette question-là. Que l’on parle de la fréquentation de l’Écriture, c’est la même chose; sur l’Épiscopat ou sur l’activité missionnaire de l’Église elle-même. On ne peut pas penser non plus sur l’activité missionnaire en dehors de la déclaration sur la liberté religieuse Dignitatis Humanae.
Quel que soit le sujet que les gens abordent, fatalement on y est conduit. Cela ne veut pas dire que le concile Vatican II a dit le dernier mot sur tout, mais au moins il a ouvert une réflexion qui est encore liée aux questions que l’on pose aujourd’hui.
Est-ce que cet esprit de renouvellement qu’a apporté le Concile facilite davantage le questionnement, les réflexions sur l’identité de l’Église aujourd’hui?
L’Église c’est un être vivant. Ce n’est pas un objet inerte. Son renouvellement n’est pas achevé. Elle aura toujours à se renouveler. Si bien que l’image qui a été empruntée par Jean-Paul II pour parler de Vatican II, c’était celle de la boussole. Or la boussole oriente et donne une direction. Elle ne règle pas tous les problèmes, mais au moins elle nous indique dans quelle direction aller. Je pense que Jean-Paul II a raison. C’est le service qui nous rend le Concile. Comme je le disais avant, les textes conciliaires ne contiennent pas la réponse à toutes les questions d’aujourd’hui. Mais au moins ils nous donnent une direction. En plus de nous aider à nous orienter, Vatican II nous permet de discerner. Car il est important pour l’Église de discerner sa route si elle veut aller de l’avant.
Comment voyez-vous le pontificat de François à la lumière du Concile?
Le pape François ne parle pas beaucoup du Concile Vatican II. Et c’est quasiment heureux comme cela. Il ne s’agit pas simplement de faire de Vatican II une bannière, d’en parler beaucoup mais de ne pas mettre en œuvre son orientation. Je pense que François vie très profondément de l’esprit de Vatican II.
Que pensez-vous des défis missionnaires dans le monde d’aujourd’hui?
Il faut distinguer plusieurs plans. Il y a une action missionnaire en direction de populations qui n’ont jamais connu l’Évangile. Je pense à l’Asie où il y a des immenses défis à relever. Je pense à la Chine, par exemple. Dieu sait comment ce pays a été la première destination des missionnaires québécois.
D’autre part, de plus en plus on va parler de la nécessité non seulement de l’évangélisation ici, mais que notre Église devienne missionnaire. Lorsque l’on dit cela, on parle d’autre chose… en utilisant le même mot, naturellement. On sera missionnaire auprès, et notamment, parce qu’on sera de plus en plus dans ces situations-là, d’une nouvelle génération qui n’aura pas non plus connue le christianisme. Dans ce cas-là, il faudra reprendre les choses à neuf.
Un autre cas de figure constitue la proposition de l’Évangile même à ceux qui l’ont reçu dans nos pays et qui s’en sont éloignés. Ici je ne parle pas des nouvelles générations qui, elles, connaissent peut l’Évangile, mais bien de leurs parents qui l’ont connu mais s’en sont éloignés de la foi. Donc, ceci suppose également un autre type d’action missionnaire.
Le Québec, comme bien de pays dans le monde, constitue alors une terre missionnaire…
Oui, mais pas dans sa totalité. Parce que c’est une société qui est quand même marquée par le christianisme : marquée dans ses temps – dans son calendrier –; dans ses habitudes, ses mœurs, ses législations; marquée également dans ses institutions et dans son patrimoine. De ce point de vue, l’on ne peut pas comparer le Québec avec un pays comme le Cameroun, par exemple. Il est évident lorsqu’on vient ici que l’on a à faire avec une société qui a été touchée profondément par le christianisme. Cela ne veut pas dire, pour autant, que toutes les générations ont fait l’expérience chrétienne ou l’ont connu. Et cela ne veut pas dire que des gens l’ayant connu ne s’en sont pas éloignés.
D’après vous, comment doit-on propager la foi aujourd’hui?
Il s’agit de savoir s’il y a une seule manière. Si je reste avec le modèle du Québec, on peut relever une autre situation, à savoir les gens provenant d’ailleurs qui arrivent dans cette société-là et qui ne sont pas chrétiens. Comment partager l’Évangile avec eux? Et c’est sans compter un autre cas de figure : des adultes qui sont chrétiens mais qui, n’empêche, eux aussi ont besoin d’être évangélisés. Je pense qu’on ne peut pas, indifféremment et d’une manière unique, partager l’Évangile avec toutes ces catégories de personnes.
Dans tous les cas, au moins, cela exige qu’il y ait des « évangélisateurs ». C’est-à-dire, des gens pour qui l’Évangile est quelque chose de vivant, quelque chose qui les fait vivre. Et, par conséquent, quelque chose qu’ils ont le goût de communiquer et de partager à d’autres. Il n’y a pas d’évangélisation sans qu’il y ait des évangélisateurs qui eux-mêmes vivent l’Évangile, qui n’ont pas un devoir ou qui ne vivent pas sous une loi mais qui vivent plutôt avec ce goût de le partager aux autres.
Annoncer l’Évangile relève donc plus des actes que des paroles?
On a besoin des deux. C’est se faire illusion de penser que simplement la proclamation du Kérygme va suffire, par exemple. On va vouloir vérifier si cette parole est digne de foi, si elle est crédible. Et le teste de la crédibilité c’est précisément l’agir, un agir qui concorde avec cette parole. On retrouve cette concordance de manière constante : dans son exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, le pape Paul VI écrivait qu’aujourd’hui on écoute volontiers les témoins. Alors, celui qui est témoin n’est pas simplement celui qui parle, mais c’est celui qui derrière sa parole il y a une vie. Le pape François a cité François d’Assise qui disait qu’il faut évangéliser par nos actions et, si nécessaire, par des paroles. On retrouve cette dynamique aussi dans l’Évangile. L’évangile de Dieu, c’est le Christ : par sa présence, par ses actions, par ses miracles, par son mode de vie, également par son enseignement et, en particulier, par sa mort et sa résurrection. (cf. Verbum Domini, n. 3) C’est par toute sa personne que le Christ évangélise. Et là on a une vraie distinction avec, par exemple, ce que l’on retrouve dans la tradition islamique à savoir que le Christ n’est pas un livre descendu du ciel, c’est un verbe fait chair. On a les deux expressions : on a le verbe – la parole –, mais on aussi la chair. Ce qui veut dire qu’on ne peut pas dissocier le verbe et la chair et dire que l’Évangélisation consiste uniquement en des paroles.
Le pape François parle d’une culture de la rencontre, un besoin urgent pour les générations d’aujourd’hui…
Oui. Comme je l’avais mentionné plus tôt, ça prend des personnes pour évangéliser. Et non pas simplement des programmes. Il n’y aura pas d’évangélisation s’il n’y a pas des personnes qui partagent avec d’autres cet Évangile, et le partagent, en effet, à travers la rencontre.
Et vous : comment vivez-vous cette rencontre avec l’autre dans votre quotidien?
Quand Jésus dit qu’il nous précède en Galilée (cf. Mt, 28, 10), la Galilée pour les disciples, pour les apôtres qui étaient des pêcheurs, c’était le lieu de leur quotidien. C’était leur lieu de gagne-pain. C’est à chacun de nous de savoir quelle est notre « Galilée ». Pour moi, c’est l’université – avec des étudiants, des collègues, du personnel, etc. Et, nous dit l’évangile de Mathieu, c’est là qu’ils me verront. C’est-à-dire, c’est là qu’on peut rencontrer Jésus. Et, plus encore – pour reprendre la question de qui est mon prochain – il ne faut pas chercher des aventures missionnaires qui seraient au bout du monde pour moi. Mon milieu c’est l’université, c’est cette faculté de théologie. C’est là le lieu, au sens technique et propre du mot, où je suis envoyé – l’acte d’envoi est la missio. Ce n’est pas dans un fantasme missionnaire, mais c’est auprès des personnes que je dois devenir le « prochain » de ces étudiants. Il ne faut pas attendre d’être un héros extraordinaire et d’avoir accompli de grandes choses. Ma mission ce passe dans le quotidien. C’est intéressant de voir que le frère André est devenu saint en étant portier d’un collège. Alors, n’attendons pas de faire des choses extraordinaires. Notre rendez-vous c’est vraiment notre quotidien en « Galilée ».
Est-ce que cela vous motive de penser que votre ministère est en quelque sorte un héritage pour les générations à venir?
C’est une des fonctions qu’on a – et c’est une belle affaire –, de dire : « un jour on va passer la main ». Le but de la formation qu’on donne est de permettre à d’autres d’émerger, de devenir autonome, de jouer leur rôle et d’être actif ailleurs dans l’Église. C’est un beau métier finalement… Celui d’« engendrer » à leur vie; de permettre, concrètement, à un bon nombre de gens qui passent par ici – pour toutes sortes de raisons – d’exercer un ministère pastorale ici, au Québec, ou ailleurs.
* L’entrevue a été réalisé par José I. Sierra rédacteur en chef de la Revue Univers, Revue d’information et d’animation missionnaire au service de l’Église canadienne, publiée par l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.
Infolettre
Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir les toutes dernières nouvelles de nos oeuvres! Billets de blogue, nouvelles, vidéos et contenus exclusifs vous attendent à chaque mois!
Le Pape compte sur votre engagement
Contribuez au développement de l'Église en terre de mission, et apportez l'espoir du Christ.
Faire un don